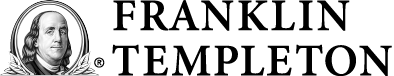Points essentiels à retenir
- Les préoccupations relatives à un ralentissement économique ont entraîné une baisse de deux indicateurs de récession axés sur le marché, à savoir les matières premières et les écarts de taux, qui passent du vert au jaune, même si le tableau de bord global du risque de récession reste vert.
- La flambée des prix du pétrole a suscité des inquiétudes quant à la récession, rappelant ainsi l'expérience de l'embargo pétrolier arabe de 1973. L'examen du tableau de bord au cours de cette période constitue une étude de cas utile concernant ce qui pourrait transformer le repli observé au premier trimestre en une véritable récession.
- Si certains éléments de la période allant de 1973 à 1975 ont des similitudes avec l'environnement actuel, à savoir des dépenses budgétaires plus élevées, une politique monétaire plus souple et une démographie positive, il existe toutefois plusieurs différences importantes. L'ampleur du choc énergétique actuel est dérisoire par rapport à celui de 1973 et l'économie actuelle repose sur une base beaucoup plus solide.
Les chiffres négatifs du PIB constituent plutôt une anomalie qu'un signal d'alarme
L'économie américaine a connu un recul de 1,4 % au premier trimestre1, soit la première baisse depuis l'arrivée de la pandémie au cours du deuxième trimestre de 2020. La situation est toutefois plus complexe, car les importations (plus fortes) ont contribué à hauteur de 2,5 % au désengorgement de la chaîne d'approvisionnement. Ce paradoxe qui se traduit par une évolution positive (l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement) et un résultat négatif (un frein au produit intérieur brut (PIB) explique peut-être pourquoi les marchés financiers ont accueilli le rapport sur le PIB comme une « bonne nouvelle », étant donné que les actions ont grimpé de 2,5 % au cours de cette journée. Les composantes essentielles du PIB, qui sont plus stables, comme la consommation et l'investissement, se sont renforcées au cours des deux derniers trimestres, ce qui est de bon augure pour une reprise de la croissance au cours du trimestre actuel. Les chiffres négatifs du PIB qui sont enregistrés dans un contexte autre que celui d’une récession ne constituent pas un phénomène sans précédent, puisque plus de 20 % de ces baisses ont lieu depuis 1950, et les plus récentes ont été enregistrées en 2014 et 2011 2.
Les perspectives économiques ne ressemblent guère à celles du début de la pandémie, car la consommation et l’activité commerciale devraient ralentir par rapport aux niveaux élevés, mais resteront toutefois favorables. Les bénéfices augmentent à un rythme satisfaisant. A ce jour, environ 75 % des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats, les excédents de bénéfices ont été importants et généralisés, et les prévisions ont été meilleures que la moyenne.
Tableau 1 : Tableau de bord du risque de récession de ClearBridge

Sources : ClearBridge Investments.
Malgré cela, les écarts de taux se sont élargis, car la crainte d'un ralentissement économique et la montée des risques géopolitiques ont amené les investisseurs à exiger une plus grande rémunération pour investir dans des obligations de moindre qualité. La situation des matières premières s'est dégradée pour passer au jaune en raison des mesures de confinement chinoises qui ont réduit la demande de produits industriels tels que le cuivre et l'acier, tandis que la guerre en cours en Ukraine a contribué au maintien de la hausse des prix du pétrole. Cependant, les indicateurs d'équilibre restent dans le vert, grâce à la force d'indicateurs tels que les demandes d'allocations chômage, qui ont atteint leur plus bas niveau en 53 ans le mois dernier3, ce qui indique que le dynamisme du marché de l'emploi stimulera la consommation et l'activité économique.
La hausse des prix du pétrole a fait resurgir le spectre de la stagflation des années 1970. Cependant, nous pensons que l’économie actuelle est mieux placée pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, compte tenu de l’augmentation des revenus et des gains de productivité, une dynamique que nous avons déjà soulignée dans notre blog « Résilience en temps de guerre ». En outre, l’histoire montre que tous les chocs pétroliers ne sont pas égaux, et que le point de départ de l’économie est un facteur déterminant pour savoir si une récession s’ensuivra, comme nous l’avons mentionné précédemment dans notre article « Vision à long terme : Quand les colombes crient ». Il est important de noter que l’économie américaine était dans une position plus forte lors de la flambée des prix du pétrole au premier trimestre qu’au début de l’embargo pétrolier arabe de 1973, avec 10 signaux verts sur le tableau de bord de la récession à l’époque, contre seulement trois sur 11 en 1973. Ce point de départ plus solide ne signifie pas que des fissures n’apparaîtront pas, c’est pourquoi il est judicieux de revoir l’évolution du tableau de bord pendant la récession qui a eu lieu de 1973 à 1975 pour avoir une certaine perspective.
Les germes de l’inflation et de la récession des années 1970 se sont accumulés au fil du temps.
Même si l’embargo pétrolier a commencé en octobre 1973, à la suite de la guerre du Kippour entre Israël et une coalition d’États arabes dirigée par l’Égypte et la Syrie, les origines de la récession et de la période de forte inflation remontent beaucoup plus loin. L’inflation a commencé à s’accélérer au milieu des années 60 sous l’administration Johnson, qui a mis en place un programme de dépenses budgétaires plus importantes pour financer la guerre du Vietnam et étendre la portée des programmes de protection sociale connus sous le nom de « Grande Société ». Cette évolution a coïncidé avec des changements démographiques positifs, puisque les baby-boomers sont entrés dans la vie active et ont fait grimper la demande (et les prix) alors qu’ils atteignaient leurs années de rémunération et de dépenses maximales. Pendant ce temps, la Réserve fédérale (Fed) a maintenu une politique monétaire très souple pour aider à financer les déficits plus élevés, ce qui a amené les investisseurs étrangers à s’interroger sur la capacité des États-Unis à maintenir l’étalon-or. La faiblesse et la ruée sur le dollar américain qui en ont résulté ont finalement conduit l’administration Nixon à abandonner l’étalon-or en 1971, ce qui a entraîné un contrôle des prix et des salaires.
Bien qu’il y ait quelques ressemblances avec le contexte actuel, notamment des dépenses budgétaires plus élevées, une politique monétaire plus souple et des données démographiques positives, il existe néanmoins plusieurs différences importantes. Au-delà du scénario du cygne noir d’une pandémie mondiale, la durée des dépenses budgétaires élevées a été beaucoup plus courte, car les déficits publics ont été réduits de manière substantielle et sont en passe de revenir aux niveaux précédant la pandémie au cours de cette année. Le soutien de la Fed a également été relativement bref, puisque la première hausse des taux d’intérêt du cycle actuel a déjà eu lieu et de nombreuses autres sont attendues dans le but de normaliser la politique « au plus vite ». En outre, le processus de resserrement quantitatif qui devrait débuter bientôt donne à la Fed un autre levier pour ralentir l’inflation.
En effet, les États-Unis ne sont pas soumis à l’étalon-or, ce qui entraîne une dynamique totalement différente, étant donné que le dollar s’est renforcé en raison de la politique plus agressive de la Fed. Le contexte démographique est également différent, car la dynamique positive des millénaires, qui atteignent leur pic de revenus et de dépenses, est partiellement compensée par le départ à la retraite des baby-boomers. Enfin, c’est peut-être le plus important, l’ampleur du choc énergétique actuel est faible par rapport au pic de 1973, un contexte où les prix du pétrole sont passés de 3,07 dollars le baril à 11,65 dollars en l’espace de cinq mois.4 Même si les prix du pétrole ont augmenté de 58 % depuis le début de l’année5, cette augmentation est beaucoup plus modeste et moins dommageable que la hausse de 279 % enregistrée au début de la récession de 1973.
Il existe également des différences fondamentales dans le tableau de bord qui a précédé la récession, avec une inversion de la courbe de rendement en juin 1973, cinq mois avant la flambée des prix du pétrole et sept mois avant le début de la récession. Avant cette flambée des prix du pétrole, la courbe de rendement, les nouvelles commandes ISM et les permis de construire ont tous affiché un signal rouge, et présentement, ils sont tous passés au vert. Les marges bénéficiaires et les ventes au détail apparaissaient toutes deux en jaune au début du pic de 1973, mais elles s’affichent actuellement en vert. Cependant, il y a quelques similitudes, avec la croissance des salaires qui apparaissait en rouge à l’époque et qui continue à apparaître ainsi aujourd’hui, et la masse monétaire qui s’affiche en jaune aux deux moments.
Tableau 2 : Évolution du tableau de bord des années 1973 à 1975

Sources : BLS, Réserve fédérale, Census Bureau, ISM, BEA, American Chemistry Council, American Trucking Association, Conference Board et Bloomberg. Le tableau de bord du risque de récession de ClearBridge a été créé en janvier 2016. Les signaux de récession présumés avant janvier 2016 sont fondés sur la façon dont les données sous-jacentes ont influencé les indicateurs composants à l’époque.
Le tableau de bord était moins reluisant en 1973, avant la flambée des prix du pétrole, malgré le signal vert dominant. Le choc pétrolier ainsi que les défis susmentionnés ont entraîné une détérioration rapide de la situation qui s’est traduite par un signal jaune généralisé et le début de la récession, avant de tomber dans le signal rouge au début de l’année 1974. À certains égards, cela ressemble à l’apparition soudaine de la COVID-19 en 2020, qui a provoqué une détérioration rapide du tableau de bord et le début quasi instantané d’une récession, même si le signal global était déjà jaune, et ce depuis la mi-2019.
Cela fait maintenant deux mois que la flambée des prix du pétrole est en cours. Malgré un léger affaiblissement, le signal global du tableau de bord reste vert. Bien qu’il y ait des similitudes avec la situation de 1973, les différences sont beaucoup plus nombreuses, et la plus importante est une économie de départ plus forte. Bien qu’une nouvelle détérioration du tableau de bord soit probable dans les mois à venir, les données récentes indiquent qu’un signal rouge global n’est pas en vue.
Notes à la fin du document
- Sources : Reuters.
- Sources : Ibid.
- Sources : Ibid.
- Sources : Réserve fédérale.
- Sources : Reuters.
Définitions
Le Tableau de bord de ClearBridge sur le risque de récession est un ensemble de 12 indicateurs qui examinent la vigueur de l’économie américaine et la probabilité d’un ralentissement économique.
L’indice S&P 500 est un indice non géré de 500 actions qui, dans l’ensemble, témoigne des résultats des grandes entreprises aux États-Unis.
L’Institute for Supply Management (ISM) est une association de professionnels de la gestion des achats et de l’approvisionnement, qui mène régulièrement des sondages auprès de ses membres pour déterminer les tendances au sein de l’industrie.
Le Bureau of Economic Analysis (BEA) est une agence du ministère du commerce qui produit des statistiques sur les comptes économiques permettant aux décideurs du gouvernement et du monde des affaires, aux chercheurs et au public américain de suivre et de comprendre les résultats de l’économie nationale. Pour ce faire, le BEA collecte des données sources, effectue des recherches et des analyses, élabore des méthodes d'estimation et les met en œuvre, puis diffuse des statistiques au public.
Le Conseil de la Réserve fédérale (la « Fed ») est responsable de la formulation des politiques américaines visant à promouvoir la croissance économique, le plein emploi, la stabilité des prix et une structure durable des échanges et des paiements internationaux.
QUELS SONT LES RISQUES ?
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez noter qu'un investisseur ne peut pas investir directement dans un indice. Les performances des indices non gérés ne tiennent pas compte des frais, dépenses ou droits d'entrée.
Les titres de capital sont sujets à des fluctuations de cours et peuvent occasionner une perte de capital. Les titres obligataires exposent leurs détenteurs aux risques de taux d’intérêt, de crédit, d’inflation et de réinvestissement, ainsi qu'à une possible perte de capital. Quand les taux d’intérêt augmentent, la valeur des titres obligataires diminue. Les investissements internationaux sont sujets à des risques spéciaux, dont les fluctuations des devises, ainsi que les incertitudes sociales, économiques et politiques qui peuvent en accentuer la volatilité. Ces risques sont amplifiés dans les marchés émergents. Les matières premières et les devises comportent des risques accrus qui incluent les conditions du marché, politiques, réglementaires et naturelles et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.
Les bons du Trésor américain sont des titres de créance émis et garantis explicitement par le gouvernement américain. Le gouvernement américain garantit le paiement du principal et des intérêts sur les bons du Trésor américain lorsque les titres sont détenus jusqu'à l'échéance. À la différence des bons du Trésor américain, les titres de créance émis par les agences et intermédiaires fédéraux et les investissements connexes peuvent ou non être garantis par la garantie explicité du gouvernement américain. Même lorsque le gouvernement américain garantit le paiement du principal et des intérêts sur les titres, cette garantie ne s'applique pas aux pertes résultant de la baisse de la valeur de marché de ces titres.