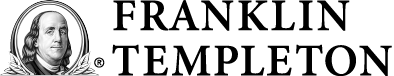CONTRIBUTEURS

Stephen Dover, CFA
Chief Market Strategist,
Head of Franklin Templeton Institute
Article initialement publié dans le bulletin d’information « Global Market Perspectives » de Stephen Dover sur LinkedIn. Suivez Stephen Dover sur LinkedIn, où il publie ses réflexions et observations ainsi que son bulletin d’information Global Market Perspectives.
Si les actuelles négociations sur le plafond de la dette engendrent une volatilité à court terme sur les marchés des capitaux, la question de l’augmentation de l’endettement national est une problématique de longue date, avec de potentielles retombées à long terme.
Plutôt que de spéculer sur le déroulement des politiques à court terme, nous pensons qu’il est plus important d’étudier les causes profonds des niveaux élevés de dette publique et de leurs potentielles répercussions pour la croissance, l'inflation et d’autres fondamentaux influant sur les prix des actifs à long terme. Nous nous demandons plus précisément à quoi tient l’explosion de la dette publique nationale au cours de 15 dernières années ? Trouve-t-elle son origine dans l’augmentation des dépenses ou la baisse des recettes fiscales, ou dans les deux ? Comment le gouvernement fédéral collecte-t-il les impôts et qu’est-ce qui constitue ses dépenses ? Existe-t-il des antécédents de réduction de la dette publique et, le cas échéant, quelles sont les conséquences probables pour les fondamentaux économiques ?
Pourquoi la dette américaine a-t-elle augmenté si rapidement ?
Depuis 2007, la dette publique fédérale des États-Unis - exprimée en dollars ou en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) américain - a explosé. Fin 2007, à l’aube de la crise financière mondiale (CFM), la dette publique fédérale américaine s’élevait à 9 200 milliards de dollars, soit 62,7 % du PIB. Quinze ans plus tard, fin 2022, la dette publique fédérale totale avait atteint 31 400 milliards de dollars, soit 120,2 % du PIB.1
Si les États-Unis ont enregistré des déficits budgétaires persistants au cours des quinze dernières années, deux événements majeurs - la CFM de 2008-2009 et la pandémie de 2020-2021 - ont massivement augmenté l’ampleur des déficits budgétaires américains.
Illustration 1 : Dépenses et recettes publiques fédérales américaines en pourcentage du PIB 1968-2033
Budget des États-Unis en pourcentage du PIB
1968–2033 (estimations)

Mai 2023. Sources : Bureau du budget du Congrès des États-Unis, Macrobond. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com. Rien ne garantit que les prévisions, projections ou estimations se réalisent.
Sur l’augmentation totale de la dette publique fédérale américaine survenue depuis 2007 (à savoir 22 300 milliards de dollars), 63 % de ce montant se sont cumulés en raison des déficits budgétaires apparus à la suite de la CFM et de la pandémie combinées.2 Autrement dit, si l’on imagine un monde où la CFM et la pandémie ne se seraient jamais produites, de plausibles estimations suggèrent que l'actuel niveau de dette publique fédérale américaine par rapport au PIB serait inférieur à 100 %, contre 120 % aujourd’hui.3
L’augmentation significative des déficits est associée aux chocs liés à la CFM et à la pandémie, en raison à la fois de la hausse des dépenses et de la baisse des recettes fiscales. Toutefois, pendant l’épisode de la CFM, les augmentations des dépenses et la baisse des recettes fiscales ont grossièrement contribué à parts égales au déficit budgétaire, tandis que durant la pandémie, c’est l’augmentation des dépenses publiques qui en est principalement en cause. Il est aussi évident que la baisse des dépenses publiques et l’augmentation des recettes fiscales (en pourcentage du PIB) depuis 2021 ont entraîné un rétrécissement rapide et significatif du déficit budgétaire au cours des 18 derniers mois.
Perspectives à plus long terme
Il s’avère également utile de tenir compte de ces évolutions dans le contexte à long terme de la politique budgétaire américaine.
Pendant la majeure partie de ces 60 dernières années, les dépenses publiques ont dépassé les recettes, les déficits budgétaires constituant la norme. Plusieurs autres tendances et évolutions valent néanmoins la peine d’être soulignées.
Premièrement, deux « régimes » d’imposition et de dépenses différents ont été mis en évidence au cours des quatre dernières décennies.
De 1983 à 2001, les États-Unis ont progressivement mis en œuvre des politiques de restrictions des dépenses, au moins par rapport au taux de croissance de l’économie. Les dépenses publiques américaines en pourcentage du revenu national ont progressivement décliné, passant de 22,9 % du PIB (1983) à 17,7 % (2001).
Dans le cadre du second régime - de 2000 à 2020 - les États-Unis ont évolué vers un régime à plus faible imposition. Pendant ces deux décennies, les recettes fiscales américaines (en pourcentage du revenu national) ont régulièrement baissé, passant de 20,0 % du PIB (2000) à 16,2 % (2020).
Durant le premier épisode - en particulier pendant les années 1990 - la baisse des dépenses publiques et l’augmentation des recettes fiscales (après 1993) ont engendré un déclin significatif puis l’élimination du déficit budgétaire fédéral. En revanche, de 2000 à l’aube de la pandémie, les augmentations de dépenses publiques a été accompagnée avec une baisse des recettes fiscales publiques pour produire des déficits budgétaires chroniques.
En bref, depuis le début des années 1980, le gouvernement américain a d’abord mis en œuvre des politiques plutôt stricte en termes de budget, mais a cumulé depuis 2000 des déficits chroniques en raison des tendances à la hausse des dépenses et à la baisse des recettes fiscales, en pourcentage du revenu national.
Croissance et réduction du déficit sont compatibles
Ces tendances sont importantes pour plusieurs raisons. Premièrement, il est possible de soutenir une solide croissance économique tout en mettant en œuvre une consolidation budgétaire. Au cours de la première sous-période (1983-2001), l’économie américaine a connu une rapide croissance, en particulier de 1995 à 2001. La rapide croissance a favorisé la consolidation budgétaire, les restrictions de dépenses (à partir de 1983) et l’augmentation des recettes fiscales (à partir de 1993) contribuant à réduire le déficit.
Il convient de souligner ce point. Le plafonnement ou la réduction de la dette publique n’a pas à sacrifier la croissance et l'augmentation du niveau de vie.
Toutefois, comme le montre aussi la seconde sous-période, la croissance seule n’entraînera pas nécessairement une réduction du déficit et de la dette. Pendant les deux premières décennies de ce siècle, même les périodes de croissance raisonnable et de chômage exceptionnellement bas n’ont pas généré les mêmes bienfaits budgétaires que ceux observés dans les dernières décennies du siècle dernier.
Cela s’explique d'une part par les guerres trop coûteuses, et d’autre part par les augmentations régulières de dépenses publiques en faveur de prestations liées à l’âge, dont les dépenses de santé. Ceci dit, par rapport à la situation de 1990, la grande différence réside dans la tendance à la baisse des recettes fiscales en pourcentage du PIB. D’importantes réductions d’impôts en 2001 puis en 2017 ont contribué à ce résultat. A cet égard, il convient aussi de souligner que les significatives réductions des taux d’imposition sur les revenus des particuliers et des entreprises n’ont pas aidé à augmenter les recettes fiscales globales.
Où vont les dépenses, et comment les finançons-nous ?
Enfin, dans le contexte de la querelle politique autour de la politique budgétaire, il peut s’avérer utile de présenter des chiffres sur les objets des dépenses publiques et les contribuables.
Du côté des recettes, l'essentiel des recettes fiscales fédérales américaines sont issues des impôts sur le revenu des particuliers et sur les salaires. En 2022, par exemple, 84 % des recettes fiscales fédérales étaient collectivement issues de l’impôt sur le revenu des particuliers et de l’impôt sur les salaires. En revanche, les impôts sur le revenu des entreprises ont représenté 8,7 % des recettes publiques fédérales totales.
En termes de dépenses, seuls 28 % du total des dépenses publiques fédérales américaines sont discrétionnaires tandis que 72 % sont obligatoires.4 Les dépenses discrétionnaires désignent l'argent que le Congrès doit autoriser chaque année, avant que le président ne promulgue la loi. Les dépenses discrétionnaires incluent la défense, santé, éducation, les dépenses agricoles et liées aux affaires internationales. Des programmes obligatoires sont d’autre part requis par la législation en vigueur et se déroulent automatiquement sans autorisation législative annuelle. Les dépenses obligatoires portent par exemple sur la Sécurité sociale, Medicare, Medicaid et les intérêts sur la dette nationale.
Illustration 2 : Les dépenses obligatoires en pourcentage du PIB ont grimpé en flèche durant la pandémie. Le Bureau du budget du Congrès des États-Unis s’attend à une augmentation progressive des dépenses obligatoires et des intérêts nets en pourcentage du PIB au cours des dix prochaines années.
Dépenses budgétaires des États-Unis
1968–2033 (estimations)

Mai 2023. Sources : Bureau du budget du Congrès des États-Unis, Macrobond. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com. Rien ne garantit que les prévisions, projections ou estimations se réalisent.
Si toutes les dépenses peuvent théoriquement faire l’objet de négociations, les dotations annuelles sont décidées pour les programmes discrétionnaires uniquement (c.-à-d. pour à peine plus d’un quart de l’ensemble des dépenses). Les principaux secteurs des dépenses discrétionnaires (1 600 milliards de dollars en 2021) sont la défense (environ 40 % du total), la santé, l’éducation et les prestations des anciens combattants. À l'autre extrémité, représentant 3 % ou moins des dépenses publiques totales, se trouvent des secteurs comme la science, les affaires internationales ou les politiques énergétiques.
L'impact des paiements d’intérêts
Sur la plupart des 15 dernières années, les très faibles taux d’intérêt ont permis de garder sous contrôle le montant des intérêts versés pour gérer le stock de dette nationale. Juste avant la pandémie, par exemple, les dépenses publiques fédérales brutes annuelles destinées à payer les intérêts sur la dette nationale s’élevaient à environ 500 milliards de dollars. Seulement trois années plus tard, conséquence de la nette augmentation de l’endettement et de la hausse des taux d’intérêt, ce chiffre a quasiment doublé pour atteindre 930 milliards de dollars.5 Selon les estimations du Trésor américain, le coût du service de la dette publique fédérale américaine représente 13 % des dépenses publiques fédérales totales en 2023.6
L’augmentation des paiements d’intérêts présente des défis budgétaires. Toutes choses égales par ailleurs, elle réduit la capacité de dépenses dans d’autres domaines.
Illustrations 3 et 4 : Une augmentation des paiements d’intérêts à venir
Solde budgétaire total des États-Unis et dépenses en intérêts nets
1968–2033 (estimations)

Mai 2023. Sources : Bureau du budget du Congrès des États-Unis, Macrobond. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com. Rien ne garantit que les prévisions, projections ou estimations se réalisent.
Paiements d’intérêts aux États-Unis en pourcentage du PIB et des revenus
2023–2026 (estimations)

Mai 2023. Sources : Bureau du budget du Congrès des États-Unis, Macrobond. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com. Rien ne garantit que les prévisions, projections ou estimations se réalisent.
En parallèle, il convient de noter que les charges d’intérêts constituent aussi une source de revenu pour de nombreux Américains - directement et indirectement par le biais de programmes d’épargne retraite. L’un des bénéficiaires nets, par exemple, est la sécurité sociale, qui investit l’excédent de revenus (par le biais de prélèvements sur les salaires) sur les dépenses courantes en bons du Trésor américain et obligations.
Conclusions
Cinq grandes conclusions se dégagent de notre analyse.
Premièrement, l’augmentation rapide de l’endettement des États-Unis depuis 2000 s’explique essentiellement par l’arrivée de deux chocs économiques majeurs - la CFM et la pandémie. Sans ces catastrophes, la dette publique serait bien inférieure (peut-être autant que d’un cinquième) et les débats sur la politique budgétaire américaine ne seraient probablement pas aussi vifs.
Deuxièmement, l’augmentation des charges d’intérêts sur la dette publique américaine représente une part grandissante des dépenses publiques. Au fil du temps, les charges d’intérêts limiteront sans doute les dépenses publiques et/ou nécessiteront une augmentation des recettes fiscales.
Troisièmement, les origines de l’augmentation de la dette publique au cours de ce siècle reflètent une combinaison d’augmentations des dépenses publiques et de diminutions des recettes fiscales. Cette situation se démarque nettement des deux décennies ou presque de consolidation budgétaire progressive du début des années 1980 jusqu’à 2001. Cette évolution montre le défi politique fondamental portant sur les moyens de financement des dépenses que les Américains semblent nécessiter ou souhaiter.
Quatrièmement, la consolidation budgétaire à long terme ne s’oppose pas à une solide croissance soutenue et à un niveau d’emploi élevé. En effet, une forte croissance est sans doute une condition économique et politique préalable à la réduction du déficit et de la dette.
Cinquièmement, étant donné que la consolidation budgétaire soutenue est plus facile à réaliser en même temps qu’une croissance forte et continue, la question se pose sur la manière d’atteindre cette dernière. Cette question s’avère d'autant plus cruciale que les effets de la mondialisation s'estompent et que la croissance de la productivité reste faible (malgré la rapidité des innovations). Les défis liés à la lutte contre l’endettement exigeront sans doute de nouveaux efforts pour stimuler la productivité.

Stephen Dover, CFA
Chief Market Strategist,
Franklin Templeton Institute
- Source : Réserve fédérale de Saint-Louis, Office of Management and Budget.
- La dette publique totale a augmenté de 22 300 milliards de dollars, passant d’un total de 9 100 milliards de dollars à 31 400 milliards de dollars en 2022. De 2008 à 2013 (CFM) et de 2020 à 2021 (pandémie), les déficits budgétaires américains cumulés s’élevaient à 14 000 milliards de dollars, soit 63 % de l’augmentation totale de l'endettement depuis 2007.
- Par exemple, la dette publique totale en pourcentage du PIB serait de 93 % aujourd’hui si la moitié des déficits budgétaires enregistrés à la suite de la CFM et de la pandémie ne s’étaient jamais matérialisés.
- Source : Peter G. Peterson Foundation.
- Sources : Réserve fédérale de Saint-Louis, Bureau of Economic Analysis.
- Source : Trésor américain.
QUELS SONT LES RISQUES ?
Tout investissement comporte des risques, notamment celui de ne pas récupérer le capital investi. La valeur des investissements peut fluctuer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer la totalité de leur mise initiale. Les cours des actions peuvent fluctuer, parfois de manière rapide et brutale, en raison de facteurs propres à des sociétés, industries ou secteurs spécifiques ou du marché dans son ensemble. Les prix des obligations évoluent généralement dans le sens opposé des taux d’intérêt. Ainsi, lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur d’un portefeuille obligataire peut reculer.