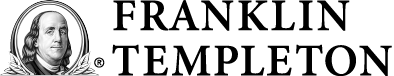Pourquoi cet article de The Economist a-t-il été sélectionné ?
Les défis d'une région deviennent les opportunités d'une autre. L'énergie bénéficie actuellement de nombreux catalyseurs, qu'il s'agisse de perturbations liées à la guerre, au climat ou aux transitions politiques. Cet article montre comment les tentatives d'investissement passées peuvent favoriser la réussite future lorsque l'occasion se présente.
- Franklin Templeton Institute
Les marchés de l’énergie sont frappés par un double choc sans précédent. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, l’Europe a réduit ses importations d’énergie en provenance de ce dernier pays, qui est le deuxième producteur mondial de gaz naturel et le troisième producteur mondial de pétrole. Les prix de ces deux sources d’énergie sont montés en flèche avant de redescendre, mais l’inquiétude persiste quant à la sécurité énergétique. Dans le même temps, le changement climatique incite à un abandon fondamental mais incertain des combustibles fossiles tels que le pétrole et, à terme, le gaz. Face à ces défis, les politiques et industriels européens s’inquiètent de savoir comment faire tourner les usines et chauffer les logements.
L’Afrique pourrait être la réponse au problème immédiat de l’Europe en matière de gaz, et à son problème à plus long terme en matière de carbone. Elle possède en effet 13 % des réserves mondiales de gaz, soit à peine moins que le Moyen-Orient, et 7 % du pétrole mondial, de même qu’un immense potentiel en énergie verte. L’énergie africaine pourrait « devenir réellement incontournable pour l’avenir de l’Europe, et pas seulement de l’Europe », déclare Claudio Descalzi, PDG d’Eni, la grande compagnie pétrolière italienne. « Ils ont beaucoup, beaucoup de gaz, ils ont du soleil, du vent… [ce qui est] parfait pour notre transition énergétique. »
Ce ne sont pas des paroles en l’air. Des entreprises énergétiques internationales, dont Eni, remettent au goût du jour des projets de production de gaz naturel liquéfié (GNL) sur l’ensemble du continent, ou en élaborent de nouveaux. Il s’agit notamment de relancer deux énormes projets de GNL qui avaient été mis en veille, dont un projet de 30 à 40 milliards de dollars en Tanzanie et un autre d’une valeur de 20 milliards de dollars au Mozambique.
Cette activité marque un changement radical par rapport à l’état d’esprit qui prévalait au cours des dernières décennies, lorsque l’Afrique perdait de son importance sur les marchés de l’énergie. Un continent qui fournissait autrefois un cinquième du GNL échangé au niveau international a perdu la moitié de sa part de marché. Sa part dans la production mondiale de pétrole et de charbon a également chuté, les investisseurs dans le pétrole, en particulier, ayant été découragés par la dégradation de la sécurité au Nigeria, qui avait l'habitude d'être le plus grand producteur du continent.
La hausse des prix, l’augmentation de la demande européenne à mesure que l’UE se détourne de la Russie et le passage du charbon au gaz, un combustible plus propre, sont à l’origine de ce changement. Et le mouvement est rapide. Le Mozambique a expédié sa première cargaison de GNL en novembre et pourrait bientôt en exporter beaucoup plus. TotalEnergies, la grande compagnie pétrolière française, pourrait bientôt reprendre le déploiement d’un gigantesque projet de GNL au Mozambique, un chantier qu’elle avait dû interrompre en 2021 en raison d’une insurrection djihadiste. Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, a déclaré à The Economist que le projet était pratiquement reparti et qu’il devrait produire du gaz d’ici à 2028. L’amélioration de la sécurité pourrait également stimuler les perspectives d’un projet de GNL encore plus important à proximité, proposé par Exxon Mobil, la plus grande compagnie pétrolière occidentale, et la China National Petroleum Corporation. De l’autre côté de la frontière, en Tanzanie, Shell et Equinor, deux entreprises européennes du secteur de l’énergie, relancent leur projet de GNL de 30 à 40 milliards de dollars.
Par ailleurs, un projet de GNL au Sénégal et en Mauritanie devrait commencer à produire cette année et les perspectives de sa deuxième phase sont prometteuses. Au Nigeria, premier exportateur africain de GNL, la capacité de production devrait augmenter d’environ 35 % d’ici à 2026.
Au total, les nouveaux projets gaziers en Afrique subsaharienne pourraient ajouter quelque 90 milliards de mètres cubes à la capacité annuelle de GNL d’ici à 2030, estime Akos Losz, de l’université de Columbia. Certes, seul un cinquième environ de cette capacité est déjà en construction ou n’est pas en suspens pour des raisons de sécurité, et certains projets pourraient encore échouer. Pourtant, les entreprises du secteur de l’énergie semblent déterminées à aller de l’avant. De nouveaux projets en Afrique du Nord, où Eni vient de signer un contrat de 8 milliards de dollars pour développer deux champs libyens, pourraient fournir 30 milliards de m3 de gaz supplémentaires d’ici à 2030, estime M. Losz. Rystad Energy, un cabinet de conseil spécialisé dans la recherche énergétique, voit un potentiel similaire (voir le graphique). Si tous les projets se concrétisent, les 120 milliards de m3 ajoutés à la production actuelle de l’Afrique porteraient sa part dans la production mondiale de gaz à 8,5 %, contre 6 % aujourd’hui, même en tenant compte des augmentations massives attendues au Qatar. À elle seule, la production supplémentaire attendue en Afrique ferait plus que compenser la baisse de 70 milliards de m3 des exportations de gaz russe vers l’UE entre 2021 et 2022.
À plus long terme, l’Afrique semble appelée à jouer un rôle encore plus important sur les marchés de l’énergie. Le Forum des pays exportateurs de gaz, un club mondial de pays exportateurs de gaz, s’attend à ce que l’Afrique ajoute plus de capacité gazière que toute autre région, à l’exception du Moyen-Orient. Il estime que l’Afrique produira près de 600 milliards de m3 par an d’ici à 2050, contre 249 milliards de m3 aujourd’hui.
Développement de l’exploitation
D’autres indicateurs semblent confirmer ces prévisions favorables. Le nombre d’installations de forage en activité en Afrique, un indicateur avancé de l’exploration et de la production, est à son plus haut niveau depuis 2019, selon Rystad. Les dépenses consacrées à l’exploration et au développement en Afrique devraient atteindre 46 milliards de dollars cette année, soit le montant le plus élevé depuis 2017. Par ailleurs, la part de l’Afrique dans les dépenses mondiales en capital pour le gaz a plus que doublé depuis 2014, selon Wood Mackenzie, un autre cabinet de conseil et de recherche sur l’énergie.

Le pétrole attire également les investissements. TotalEnergies, troisième compagnie pétrolière et gazière internationale, consacrera cette année la moitié de son budget global d’exploration à la Namibie, où il semblerait qu’il y ait jusqu’à 11 milliards de barils de pétrole et potentiellement aussi du gaz. La Namibie pourrait ainsi devenir un énorme producteur. « Nous n’avons aucun doute sur le fait que cela va arriver », déclare le ministre namibien de l’Énergie, Tom Alweendo. Les exportations d’hydrocarbures, même modestes, peuvent avoir un impact important sur les pays pauvres. Prenons l’exemple du Niger, où un oléoduc d’exportation construit par la Chine est sur le point d’être achevé. « Rien que l’année prochaine, il apportera des ressources budgétaires représentant un quart de notre budget actuel », déclare Mohamed Bazoum, président du Niger. « Les années suivantes, ce sera encore plus. »
L’Afrique dispose également d’un formidable potentiel pour devenir un grand producteur d’énergie verte. Bien qu’elle possède des déserts étendus et ensoleillés, des côtes et des plaines venteuses et des fleuves à fort débit, elle est à la traîne et ne possède que 1 % de la capacité solaire et éolienne installée dans le monde et seulement 4 % de l’énergie hydroélectrique. Cela aussi est en train de changer, mais peut-être pas assez rapidement : la capacité solaire installée en Afrique a presque quadruplé depuis 2016.
L’Afrique n’a pas exploité son plein potentiel, principalement du fait des difficultés à exporter l’énergie verte. Les investissements ont été réalisés principalement pour la consommation locale d’électricité (qui représente moins de 3 % du total mondial) et même les producteurs d’électricité privés ont souvent eu du mal à gagner de l’argent parce qu’ils approvisionnaient de petits marchés par l’intermédiaire de compagnies d’État inefficaces.
Aujourd’hui, de nouvelles technologies pourraient permettre aux producteurs d’énergies renouvelables de contourner les problèmes des marchés nationaux en exportant de l’énergie. Avec des recettes d’exportation assurées, les entreprises d’énergie verte peuvent plus facilement obtenir les fonds nécessaires à la construction d’installations plus grandes et plus performantes. L’une des retombées est qu’ils devraient également être en mesure de fournir de l’électricité aux économies locales.
La première de ces opportunités d’exportation est la production de ce que l’on appelle l’« hydrogène vert », qui est obtenu en séparant l’eau en oxygène et en hydrogène à l’aide d’électricité renouvelable. Les pays riches voient dans l’hydrogène vert le meilleur espoir pour faire fonctionner leur industrie à forte consommation d’énergie tout en réduisant les émissions de carbone. Les États-Unis ont récemment introduit le plus important programme de subventions au monde pour l’hydrogène à faible teneur en carbone (qui comprend l’hydrogène produit à partir de gaz avec captage du carbone). Le nouveau programme énergétique de l’UE, conçu pour rendre l’Union indépendante des combustibles fossiles russes, a fixé pour objectif à l’Europe de produire 10 millions de tonnes d’hydrogène vert par an et d’en importer 10 millions de tonnes supplémentaires d’ici à 2030. L’AIE, un groupe de réflexion intergouvernemental, estime que le monde devra produire 90 millions de tonnes d’hydrogène à faible teneur en carbone par an d’ici à 2030 et 450 millions de tonnes par an avant 2050 pour atteindre son objectif d’émissions nettes nulles d'ici à la même année.
Le fort potentiel solaire et éolien de l’Afrique en fait un endroit intéressant pour produire de l’hydrogène vert. Une étude récente de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de développement de l’UE, affirme que l’Afrique pourrait produire 50 millions de tonnes de ce produit par an d’ici à 2035, à partir de trois sous-régions : l'Égypte, la Mauritanie et le Maroc, la Namibie et l'Afrique du Sud. La moitié environ de cette production pourrait être destinée à l’exportation. En mai, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s’est réjouie du fait que « la Namibie ait le potentiel pour devenir l’un des principaux centres d’énergie renouvelable du continent africain et du monde entier ». La banque estime que la Mauritanie et le Maroc pourraient compter parmi les producteurs les plus compétitifs au monde, avec des coûts incluant le transport jusqu’à Gibraltar d’environ 1,6 dollar par kg d’ici à 2035.
Du gaz dans le réservoir
De grands projets dans le domaine de l’hydrogène commencent à prendre de l’ampleur en Afrique. L’un des plus importants se trouve en Mauritanie où, l’année dernière, le gouvernement et CWP Global, une entreprise spécialisée dans les énergies vertes, ont signé un accord anticipé pour un projet éolien et solaire visant à produire 1,7 million de tonnes d’hydrogène vert par an. Un autre mégaprojet en Mauritanie, réalisé par la société britannique Chariot, filiale de TotalEnergies, vise à produire 1,2 million de tonnes par an. « Il s’agit d’une opportunité extraordinaire », a déclaré Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre mauritanien de l’Énergie.
L’enthousiasme est le même en Namibie, où le gouvernement a récemment achevé les négociations avec Hyphen Hydrogen Energy, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, pour la prochaine phase d’un projet de 10 milliards de dollars visant à produire 2 millions de tonnes par an d’ammoniac vert (un produit fabriqué à partir d’hydrogène vert, mais plus facile à transporter) d’ici à 2030. Il est soutenu par l’UE. « Ils ont besoin des molécules. Nous avons besoin des emplois », plaisante James Mnyupe, conseiller du président namibien.
L’hydrogène vert n’est pas la seule possibilité d’exporter de l’énergie renouvelable. Xlinks, une entreprise britannique, prévoit de construire au Maroc une centrale éolienne et solaire qui enverrait directement de l’électricité en Grande-Bretagne par le biais de 3 800 kilomètres de câbles sous-marins d’ici à 2030. Selon Xlinks, le projet pourrait fournir 8 % de l’électricité britannique à un coût nettement inférieur à celui d’autres solutions telles qu’une centrale nucléaire dont la construction a été longtemps retardée. Bien que son coût de 18 milliards de dollars constitue un obstacle considérable, le projet a attiré un financement initial de la part de la compagnie nationale d’énergie d’Abou Dhabi.
Pour que l’Afrique réalise son potentiel énergétique, elle devra toutefois éviter une série d’écueils. Le premier danger, c'est la paresse. Pour ce qui concerne le gaz naturel, des concurrents tels que le Qatar et l’Amérique agissent rapidement pour accroître leur production. Si l’Afrique tarde à fournir l’Europe, sa fenêtre d’opportunité risque de se refermer, d’autant plus que la demande se tourne vers des sources d’énergie plus vertes. L’AIE estime que, d’ici à 2030, l’UE pourrait réduire sa consommation de gaz de 20 % par rapport à 2021, en se fondant sur les politiques actuelles.
En matière de vitesse, le bilan de l’Afrique est inquiétant. Au cours des deux dernières décennies, les nouveaux projets gaziers en Afrique subsaharienne ont mis près de cinq ans de plus que prévu pour passer de la découverte à la production. Par ailleurs, les producteurs africains de pétrole et de gaz sont raisonnablement compétitifs en termes de coûts, ce qui signifie qu’ils ne seront pas les premiers à se trouver en difficulté si la baisse de la demande se répercute sur les prix. À un prix du gaz de seulement 3 dollars par 1 000 pieds cubes, les deux tiers du gaz africain sont encore rentables. Cela comprend une grande partie du gaz trouvé en Algérie, en Mauritanie et en Tanzanie. Même dans le domaine du pétrole, dominé par la production saoudienne à faible coût, l’Afrique reste largement dans la course lorsque les prix dépassent 30 dollars le baril.
Par ailleurs, la demande de gaz devrait augmenter en Afrique même, car le continent se prépare à produire de l’électricité pour les quelque 600 millions d’Africains qui n’en disposent pas actuellement. Une grande partie de ce nouvel approvisionnement proviendra probablement de sources renouvelables, mais le gaz pourrait également constituer un élément important d’un bouquet électrique stable et alimenter les fours de l’industrie lourde.
Les entreprises et les gouvernements s’efforcent également de veiller à ce que le gaz naturel africain soit extrait de la manière la plus efficace possible sur le plan climatique. Eni affirme que son gisement de pétrole et de gaz de Baleine, en Côte d’Ivoire, sera le premier en Afrique dont le développement et l’exploitation seront neutres en carbone (mais cela ne tient pas compte des émissions produites par ceux qui achètent et brûlent le pétrole et le gaz).
Le deuxième écueil majeur qui menace le boom énergétique de l’Afrique est la sécurité intérieure. Les djihadistes ont déjà provoqué des retards de plusieurs années dans la construction de mégaprojets gaziers au Mozambique et ont incité les pays voisins à envoyer des troupes pour rétablir l’ordre. Entre-temps, le Nigeria a partiellement manqué la manne des prix élevés du gaz l’année dernière, un climat d’insécurité l’ayant conduit à expédier moins de GNL en 2022 que l’année précédente.
Le troisième risque est lié aux différends concernant la répartition des rentes de la production d’énergie. Les dollars générés par les grands projets pétroliers et gaziers pourraient être accaparés par des politiques et des hommes d’affaires disposant d'une multitude de relations, au lieu de profiter à l’ensemble de la population.
Hélas, les gouvernements de la région n’investissent pas toujours de manière efficace les revenus tirés des ressources dans les infrastructures, les écoles et les cliniques. En Guinée équatoriale, par exemple, le pétrole a conforté à sa place le dictateur le plus anciennement au pouvoir dans le monde. Son fils, un playboy qui espère prendre la relève, est connu pour avoir dépensé de l’argent dans des manoirs et des voitures de sport (et pour avoir dilapidé le reste). Pendant ce temps, le peuple de Guinée équatoriale souffre. Le pays se classe au 145e rang sur 189 selon l’indice de développement humain des Nations unies, qui mesure le revenu, la santé et l'éducation.
En Afrique, il est inquiétant de constater qu’il demeure fréquent que les compagnies pétrolières et gazières soient spoliées et que leurs actifs soient nationalisés. Au Ghana, habituellement une destination de choix pour les investissements en Afrique, Tullow Oil a eu recours à l’arbitrage international après avoir reçu une facture fiscale rétroactive de 387 millions de dollars, alors que le pays est à la recherche de fonds en raison de la crise qui affecte sa dette publique. Les investisseurs qui envisagent d’injecter les milliards de dollars nécessaires à la production de GNL ou d’hydrogène vert ne le feront pas s’ils craignent pour la sécurité de leurs actifs ou un changement arbitraire des règles.
C’est particulièrement le cas pour les projets d’hydrogène vert, qui devront attirer d’énormes quantités de capitaux. Le projet proposé par la Namibie coûtera environ 10 milliards de dollars, soit un peu moins que son PIB actuel, qui s’élève à 12 milliards de dollars. L’investissement nécessaire à la vision panafricaine de la BEI, qui consiste à produire 50 millions de tonnes d’hydrogène vert par an d’ici à 2035, depuis les installations solaires jusqu’aux pipelines d’exportation, est estimé à 1 400 milliards de dollars. Le plus grand problème est de savoir si les entreprises et les gouvernements des pays riches, qui veulent de l’hydrogène vert, investiront. « Les paroles deviendront-elles des actes qui répondent aux besoins ? » s’interroge NJ Ayuk, de la Chambre africaine de l’énergie, un organisme du secteur.
Après des décennies de déclin sur les marchés mondiaux de l’énergie, l’Afrique bénéficie d’une brève période d’opportunités considérables. Pour saisir ces opportunités, les gouvernements africains devront tirer les enseignements des erreurs commises lors des précédents booms des matières premières, lorsque les investisseurs ont été effrayés et que les revenus ont été dilapidés. Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, pense que cette fois, le continent ne gâchera pas cette opportunité. Selon lui, « ce siècle est le siècle de l’Afrique ».
Informations Importantes
© The Economist Newspaper Limited, 2022. Tous droits réservés.
Tiré de The Economist, publié sous licence.
Franklin Templeton décline toute responsabilité quant à la mise à jour des opinions ou autres informations contenues dans le présent article.