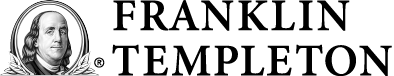Pourquoi cet article de The Economist a-t-il été sélectionné ?
Un point de vue intéressant sur les problèmes inflationnistes des marchés développés autres que les États-Unis. Le Royaume-Uni est un peu à part, avec une culture, des programmes sociaux et un environnement de marché légèrement différents. Cela montre que l'inflation - tout comme les dépenses de consommation, le chômage et d'autres facteurs - varie dans le monde entier, ce qui offre des possibilités d'investissement actif.
- Franklin Templeton Institute
Au XVIIIe siècle, les personnes responsables de la fixation des taux d'intérêt à la Banque d’Angleterre avaient la tâche facile. Pendant plus d’un siècle, de 1719 à 1821, le taux directeur de la banque centrale est resté inchangé, à 5 %. En juin, leurs successeurs, plus actifs, ont fixé les taux d’intérêt au même niveau après 13 augmentations successives dont le but était de lutter contre l'inflation annuelle, laquelle a culminé à plus de 11 % en octobre. Leur mission n’est cependant pas encore accomplie. Les investisseurs s’attendent à ce que la banque relève à nouveau ses taux le 3 août, pour les porter à 5,25 %, puis encore d'un demi-point de pourcentage d'ici à Noël.
Peu de temps après, selon de nombreux prévisionnistes, le resserrement prendra fin. L’optimisme a grandi depuis que les calculs ont révélé une inflation annuelle à 7,9 % en juin, inférieure aux attentes. Pourtant, ces dernières années, les prévisions des économistes n'ont pas toujours été très justes, tant s'en faut. En novembre, la banque elle-même a critiqué les attentes du marché selon lesquelles les taux se borneraient à atteindre un sommet vers les 5 %. Et, chose alarmante, de simples règles empiriques suggèrent que la banque pourrait encore être bien en dessous de la réalité.
La formule utilisée dans les manuels pour fixer les taux d’intérêt est la « règle de Taylor », du nom de John Taylor, de l’université de Stanford. Elle repose sur trois éléments : l’écart entre l’inflation actuelle et l’objectif d'inflation, la part de capacités inutilisées dans l'économie et, enfin, le taux d'intérêt dit neutre, auquel la banque centrale ne stimule pas l'économie et ne la freine pas. En introduisant des hypothèses plausibles pour l’économie britannique dans la règle de Taylor, on obtient une recommandation de taux d’intérêt de 11,4 %, un niveau que l’on n’avait plus vu depuis 1992, lorsque la banque tentait désespérément de défendre la livre contre une ruée sur celle-ci. Des taux aussi élevés pourraient juguler l’inflation, mais ils mettraient en péril le gouvernement et, de fait, une grande partie de l’économie.

La plupart des banquiers centraux considéreraient un tel résultat comme la preuve que l’algorithme ne fonctionne pas. Qu’est-ce qui échappe donc à la règle de Taylor ? Commençons par l’inflation. Le taux global élevé de la Grande-Bretagne reflète en partie l’effet des prix internationaux des denrées alimentaires et de l'énergie, sur lesquels la banque n'a guère de prise. Mais si l’on recourt à l’inflation de base, qui exclut les denrées alimentaires et l’énergie, la règle de Taylor suggère toujours de porter les taux d'intérêt à 9,9 %, ce qui est très pénalisant.
Ben Bernanke, ancien président de la Réserve fédérale américaine, a un jour fait une analogie entre la politique monétaire et un golfeur essayant de jouer avec un club qu’il ne connaît pas : accentuer ses swings ne mène qu'à une chose, augmenter fortement le risque d'être trop long ou trop court. En revanche, le golfeur avisé procédera à des frappes progressives pour apprendre comment réagit son matériel. Le banquier central devrait faire de même. Pourtant, même une règle de Taylor « inertielle », conçue pour éviter les fluctuations importantes des taux d’intérêt et s'appuyant toujours sur l’inflation de base, suggérerait que la banque a pris du retard et qu'elle devrait immédiatement relever ses taux à 6 %.
Comme l’a fait remarquer Huw Pill, économiste en chef de la banque, une partie du problème réside dans le fait que personne ne sait vraiment comment fonctionne l’économie. Les règles qui reposent sur des concepts peu solides de taux d’intérêt neutre ou de production potentielle réelle de l'économie peuvent induire les décideurs en erreur. Le taux d’intérêt réel neutre de 0,5 % et le taux de chômage d'équilibre de 4 % que votre correspondant a supposés reflètent des idées reçues, mais n'ont pas été calculés scientifiquement.
Janet Yellen, actuelle secrétaire d’État au Trésor américain et ancienne présidente de la Fed, a suggéré une règle de politique monétaire qui ne s’appuierait pas du tout sur des estimations d’un taux d'intérêt neutre. Au lieu de cela, elle procéderait à de petites modifications basées uniquement sur des données observables. Comme si l’on ajoutait des épices à un plat petit à petit, en le goûtant et en en rajoutant au besoin. Appliquée aujourd’hui en Grande-Bretagne, la règle de Mme Yellen aboutit toutefois à une conclusion similaire à celle de Taylor : les taux devraient être portés à 10,9 %.

La seule façon pour la banque de s’en sortir est de modifier l'exercice de manière plus fondamentale. La plupart des règles de Taylor sont rétrospectives. Or, il faut parfois plus d’un an pour que les effets de la politique monétaire se répercutent sur l'économie. Le banquier central avisé est censé « cibler la prévision » de l’inflation plutôt que de réagir avec trop de zèle à ce qui s'est déjà produit. Sinon, il risque de négliger les pressions inflationnistes ou désinflationnistes qui commencent à se développer, mais qui n’apparaissent pas encore dans les données.
Une règle de politique prospective s’appuierait donc sur des prévisions d’inflation. Les marchés financiers s’attendent à ce que le taux d’inflation soit tombé à environ 3 % dans deux ans. Les anticipations en matière d'inflation dépendent elles-mêmes des prévisions de la politique monétaire. Mais mettre de côté l'aspect « circulaire » et introduire ce chiffre dans une règle de Taylor laisse entendre que la banque court le risque d'augmenter ses taux trop fortement : le taux d'intérêt recommandé n'est que de 4,3 %. Cela permet de mieux comprendre les divergences de vues affichées par les décideurs politiques de la banque qui se sont opposés aux récentes augmentations de taux.
Le problème, c’est que les prévisions d’inflation sont parties dans tous les sens ces derniers temps. En juillet 2022, le prévisionniste moyen interrogé par le Trésor s’attendait à ce que l’inflation tombe à 3,6 % à la fin de 2023 ; aujourd'hui, le taux attendu est de 4,9 %. En mai, la banque a déclaré qu’elle avait commencé à accorder moins d’attention à son propre modèle en raison de son manque de fiabilité ; elle a depuis demandé à M. Bernanke de mener une révision de ses prévisions. Moins on croit aux déclarations des économistes selon lesquelles le problème de l’inflation va bientôt se résorber, plus il est difficile d'occulter le fait que les données concrètes indiquent que la politique monétaire est encore trop souple.
Informations Importantes
© The Economist Newspaper Limited, 2022. Tous droits réservés.
Tiré de The Economist, publié sous licence.
Franklin Templeton décline toute responsabilité quant à la mise à jour des opinions ou autres informations contenues dans le présent article.