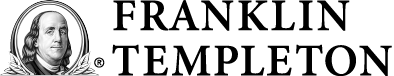CONTRIBUTEURS

Michael Hasenstab, Ph.D.
Executive Vice President, Portfolio Manager
Dans la dernière édition de Global Macro Shifts, l’équipe Templeton Global Macro analyse l’échec des gouvernements populistes en Amérique latine et les enseignements importants que peuvent en tirer les pays développés. Michael Hasenstab propose ici un résumé de l’analyse complète de son équipe.
Depuis quelques années, les idées populistes ont le vent en poupe dans de nombreux pays du monde. Si les définitions du populisme varient en fonction des personnes, pour notre part ce terme désigne les politiques promettant des solutions rapides aux problèmes, souvent de nature économique, mais sans les contraintes douloureuses qui accompagnent généralement les traitements plus classiques. Ces derniers consistent globalement à réduire les déséquilibres macroéconomiques au moyen d’outils qui sont notamment des politiques budgétaires et monétaires prudentes, la libéralisation du commerce, la déréglementation et l’ouverture vers l’intégration économique mondiale.
Au lendemain des nombreuses crises qui ont jalonné ces dix dernières années, ces remèdes traditionnels sont de plus en plus considérés comme passés de mode, et tout particulièrement dans certains pays développés. C’est dans cet état d’esprit que la majorité des électeurs britanniques se sont prononcés en faveur du Brexit, c’est-à-dire la sortie de l’Union européenne (UE) en vue de limiter l’immigration et de restaurer la souveraineté nationale en ce qui concerne le contrôle des politiques et des réglementations. Dans plusieurs autres pays d’Europe, les partis populistes et nationalistes trouvent de plus en plus d’échos favorables, ce qui crée des incertitudes quant à l’issue des élections prévues en 2017.
La campagne des présidentielles américaines a fait entendre des idées populistes particulièrement vivaces à la fois dans le camp républicain et démocrate, appelant au repli sur soi et à l’interventionnisme économique ainsi qu’à une approche isolationniste avec des propositions comme la fixation de droits de douane élevés, l’annulation ou la renégociation des traités commerciaux et des initiatives pour réduire l’immigration. En critiquant vivement l’ALÉNA et les flux migratoires en provenance du Mexique, les États-Unis ont exprimé la volonté de réduire leur ouverture vis-à-vis de l’Amérique latine. Pourtant, des mesures en ce sens seraient très dommageables à l’économie américaine en plus d’être assez paradoxales, puisqu’elles surviendraient au moment où les pays latino-américains empruntent précisément le chemin inverse et reviennent sur leurs politiques populistes pour privilégier le libre-échange et des réformes favorables aux entreprises.
Nous avons analysé l’expérience qu’ont vécue les pays d’Amérique latine depuis quelques années, en retenant trois États qui avaient choisi d’adopter une politique économique populiste : l’Argentine, le Brésil et le Venezuela. Le Brésil et l’Argentine sont en train de faire marche arrière, ce qui n’est pas le cas du Venezuela. Il nous semble que pour tout élu tenté de succomber au chant des sirènes populistes, la comparaison de ces expériences est riche d’enseignements.
Bien sûr, les fondamentaux et les institutions des économies développées sont bien plus solides que ceux des pays sur lesquels porte notre analyse, mais nous pensons que les conséquences de politiques malavisées seraient assez identiques. Notre analyse peut donc apporter un éclairage précieux, en particulier dans les périodes comme aujourd’hui, où la tentation est grande, pour certains, de céder à l’appel du protectionnisme. De plus, nous mettons en avant des opportunités d’investissement attrayantes en Argentine et au Brésil, et plus généralement dans les pays dotés de régimes économiques solides et orthodoxes.
Sirènes du populisme
L’illustration 1 représente les expériences de quatre pays d’Amérique latine, dont trois sont tombés dans le piège du populisme (l’Argentine, le Brésil et le Venezuela) mais pas le quatrième (la Colombie). Tous ces pays ont été affectés dans des proportions variables par la fin du supercycle des matières premières, qui a mis à l’épreuve la viabilité de leurs cadres politiques, et ceux qui avaient choisi la voie du populisme ont été pris en défaut. Le genre de mesures prises par les gouvernements les plus interventionnistes est donné à titre d’exemple dans l’illustration 1.

Les dégâts
Dans les trois pays ayant adopté des mesures populistes, celles-ci ont eu des conséquences très défavorables : l’inflation s’est envolée, le système économique a connu d’importantes distorsions, la croissance de la productivité a baissé, la manipulation des devises dans un environnement d’inflation élevée a entraîné une forte hausse du taux de change réel (ce qui a pesé sur la compétitivité), et dans certains cas, la dette publique s’est rapidement accrue.
En Argentine et au Brésil, ces dégâts commencent à être réparés ; mais l’expérience du Venezuela, qui persiste sur la voie du protectionnisme, parle d’elle-même. L’illustration 2 présente un aperçu des répercussions négatives du populisme dans ces pays, et l’on voit bien que la Colombie sort du lot grâce au maintien de politiques prudentes.

Marche arrière
En Argentine, la dégradation prolongée des conditions économiques a fini par chasser Cristina Kirchner du pouvoir au profit de Mauricio Macri en novembre 2015. Le nouveau Président argentin a été élu sur la promesse d’une grande libéralisation du système économique. Rapidement, le nouveau gouvernement a lancé toute une série de réformes, allant du renforcement du rôle des institutions au durcissement de la politique monétaire en passant par la consolidation budgétaire, la normalisation de la politique de change et la régularisation des relations internationales. Ces initiatives vastes et profondes marquent un net changement de cap et adressent un signal fort aux investisseurs internationaux : celui d’un gouvernement très impliqué dans la restauration de la trajectoire économique. À nos yeux, cette volonté de relever immédiatement les défis les plus durs a été le pilier central de la crédibilité de la nouvelle équipe au pouvoir.
Au Brésil, le virage politique a été amorcé sous l’ancienne Présidente, Dilma Rousseff, forcée par l’effondrement de sa cote de popularité et les difficultés du pays pour accéder aux financements extérieurs. Le nouveau gouvernement brésilien, sous la direction de Michel Temer, a lancé les premières étapes de la consolidation budgétaire avec l’abaissement du plafond des dépenses publiques et la préparation d’une réforme de la sécurité sociale. Les autorités ont aussi commencé à réduire l’interventionnisme afin d’atténuer les distorsions économiques, en commençant par déréglementer les prix administrés en 2015. Cette même année, l’inflation en hausse et la récession économique ont compliqué la tâche de la banque centrale ; après avoir maintenu un taux d’intérêt réel stable jusqu’à mi-2015, elle l’a laissé grimper (tout en commençant à réduire les taux nominaux) pour parvenir à baisser l’inflation en 2016. Autre aspect de cette nouvelle politique monétaire prudente : l’expansion du crédit lancée sous le gouvernement précédent a été interrompue.
En Colombie, bien que les politiques ne se soient pas réellement dégradées, le gouvernement a quand même pris des mesures pour réduire l’inflation liée à la dépréciation du peso. La politique monétaire a été durcie, des mesures ont été prises pour consolider les comptes publics et pouvoir parer les effets potentiels de la baisse des recettes liées à la chute des cours pétroliers, et enfin, des négociations ont été menées avec les Forces armées révolutionnaires – Armée du Peuple (FARC-AP) pour mettre un terme au conflit de longue date avec ce groupe de guérilla, ce qui a contribué à renforcer et sécuriser les institutions démocratiques du pays.
À l’heure où nous écrivons, les politiques populistes battent toujours leur plein au Venezuela. La population vit aujourd’hui dans des conditions très difficiles, avec un taux de chômage élevé et un accès restreint aux produits alimentaires et à d’autres ressources essentielles. Cette situation a suscité des mouvements de protestation et accru le risque d’instabilité sociale, mais n’a pas encore entraîné de changement du régime politique, ni même un ajustement. L’illustration 3 présente un résumé des ajustements mis en place (ou non) par chaque pays couvert par notre étude.

Comment fonctionnerait le BAT
Avec le nouvel impôt sur le revenu des sociétés envisagé dans le projet de réforme républicain, l’ajustement aux frontières fonctionnerait de la façon suivante :
- Les recettes des exportations seraient exemptées de la base imposable pour l’impôt sur les sociétés ;
- Le coût des produits nationaux serait soustrait à la base imposable, mais pas le coût des produits importés.
Dans l’ensemble, la réforme opérerait un virage d’un système mondial vers un système territorial fondé sur le lieu de consommation plutôt que sur le lieu de production, d’un système permettant la déduction d’intérêts vers un système ignorant largement les flux financiers, et enfin d’un impôt sur le revenu vers un impôt sur la consommation. Tandis que l’ajustement aux frontières serait une nouveauté au sein du système fiscal américain, la plupart des autres pays l’appliquent déjà sous la forme d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), une taxe à la consommation intégrant une composante d’ajustement aux frontières. En termes d’impact économique, le BAT équivaudrait à adopter la TVA tout en supprimant la taxe salariale.
Les raisons pour lesquelles le BAT est contesté
- Politiquement controversé: Toutes les réformes fiscales produisent des perdants et des gagnants, mais une modalité d’ajustement aux frontières fait monter les enchères pour les secteurs exportateur et importateur (comme le montrent les actions de lobbying intense).
- Des implications économiques incertaines: L’ajustement économique pourrait avoir un effet perturbateur sur les prix, les bénéfices, les chaînes d’approvisionnement, les flux commerciaux et les taux de change. À noter, cependant, que toutes les autres économies avancées ont déjà survécu à l’imposition de taxes à la consommation ajustées aux frontières (TVA) et s’y sont adaptées.
- Conformité à l’OMC: Actuellement, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) permet l’ajustement aux frontières pour les impôts indirects, mais pas pour les impôts directs. Il semble donc qu’un impôt sur le revenu des sociétés avec un ajustement aux frontières violerait les règles de l’OMC, ce qui pourrait entraîner des plaintes et des mesures de rétorsion. Toutefois, comme nous l’avons signalé auparavant, la proposition républicaine serait l’équivalent exact d’une TVA—autorisée par l’OMC—avec en prime la suppression de la taxe salariale, une décision fiscale purement nationale échappant à la compétence de l’OMC. Ainsi, les objections de l’OMC semblent n’avoir aucun fondement économique justifiable.
Impact sur les taux de change et les prix
La théorie économique nous dit qu’un ajustement fiscal aux frontières, tel que la TVA, ne devrait avoir aucun impact à long terme sur les flux commerciaux. L’équilibre commercial par définition équivaut à l’équilibre épargne/investissement d’un pays. Si une TVA, en tant que taxe à la consommation, encouragerait l’épargne, elle encouragerait également l’investissement. Cet argument s’applique aussi à la proposition de BAT. En théorie, sur le long terme, l’impact net sur le solde épargne/investissement sera neutre et le taux de change s’appréciera afin de compenser la mesure dans laquelle le BAT rendrait les importations moins compétitives (et les exportations plus compétitives). À longue échéance, le taux de change du dollar américain devrait s’apprécier pour contrebalancer l’impact de la taxe sur la compétitivité. À courte et moyenne échéance, cependant, il est probable que l’ajustement ne soit que partiel. Cet ajustement partiel du taux de change entraînerait une hausse du prix des produits importés, avec une progression temporaire de l’inflation qui, d’après nous, tournerait autour d’un point de pourcentage.
Impact sur les secteurs nationaux et les flux commerciaux
Suite à la réponse immédiate des prix, la production nationale et les tendances commerciales s’adapteraient à mesure que les entreprises répondraient à la nouvelle taxe et au nouvel environnement concurrentiel. Bien que les avantages offerts par un taux d’imposition des sociétés plus bas serait amplement partagé, le BAT aurait un impact différencié sur les divers industries et secteurs :
- Les bénéfices des importateurs américains seraient resserrés, tandis que certains exportateurs et sociétés concurrencées par les importations en sortiraient gagnants ;
- Les concurrents étrangers seraient susceptibles de réduire les prix hors taxes et d’accepter une baisse des profits afin de maintenir leur part sur le marché américain ;
- Une perturbation immédiate des chaînes d’approvisionnement se ferait probablement sentir (en particulier en raison des multiples mouvements transfrontaliers)—les sociétés américaines essaieraient de remplacer les produits nationaux par des produits importés partout où cela serait possible ;
- L’impact des valorisations sur le dollar américain et les actifs libellés en devises étrangères nuirait aux américains détenant des actifs à l’étranger ou aux étrangers ayant des titres d’emprunt libellés en dollars.
L’impact réel sur les bénéfices d’une société dépendraient de nombreux facteurs et varieraient considérablement au sein des secteurs. Pour offrir un contexte, l’explication ci-dessous exprime la réduction de l’impôt net sous forme de part de production industrielle brute face à la dimension du secteur, en préssuposant un BAT de 20 % et une réduction de l’impôt sur les sociétés de 15 %.1 Dans notre analyse, les catégories de produits relativement petits de l’habillement, en cuir et associés, ainsi que les usines de textile et les usines de produits textiles seraient les plus grands perdants. En outre, les concessionnaires de véhicules à moteur et les fournisseurs de pièces, ainsi que les produits informatiques et électroniques—tous deux des catégories de produits bien plus grands—seraient parmi les éminents perdants en termes d’impact immédiat de la réforme.2 Par ailleurs, les secteurs tels que celui des autres équipements de transport (y compris celui de l’aéronautique) et des produits chimiques devraient bénéficier de la réforme. Dans les autres cas, le bilan est plus nuancé : Par exemple, les entreprises spécialisées dans l’extraction du pétrole et du gaz en seraient bénéficiaires, tandis que les producteurs de produits dérivés du pétrole et du charbon en ressortiraient déficitaires, en raison des tensions entre les raffineries et les producteurs de schiste bitumineux.
L’impact macro-économique à plus long terme
Cette réforme fiscale représentant un changement historique dans le système d’imposition américain, elle aurait un impact macro-économique important à plus long terme. La réforme fiscale globale présente plusieurs traits positifs capables d’améliorer considérablement l’environnement économique, de stimuler la productivité, la compétitivité et la croissance :
- Une réduction d’impôt : Une réforme fiscale ambitieuse occasionnerait une réduction significative du taux d’imposition des sociétés. L’impôt sur le revenu des particuliers pourrait également être réduit.
- Une plus grande efficacité : Non moins important est le fait qu’une réforme réussie simplifierait et améliorerait l’efficacité du système de taxation américain—souvent perçu comme très complexe et non rentable.
- Rapatriement : Un système territorial réduirait les incitations à maintenir les bénéfices à l’étranger. Il est probable qu’un taux d’imposition bas et ponctuel induise le retour de bénéfices non imposés accumulés détenus à l’étranger, ce qui pourrait stimuler l’activité nationale. Il a également été suggéré que la charge fiscale sur les bénéfices rapatriés pourrait être compensée par des crédits d’impôt conçus pour encourager l’investissement dans des projets d’infrastructure.
L’économie américaine semble déjà prête pour une reprise cyclique de l’investissement ; néanmoins, une réforme réussie de l’impôt sur les sociétés contribuerait largement à la promotion des incitations à l’investissement réel à long terme. Étant donné que le faible niveau d’investissement a été identifié comme un contretemps potentiel à la croissance de la productivité depuis la crise financière mondiale, ce changement en matière d’incitatifs pourrait avoir des effets positifs forts et durables.
Conclusion
La mise en place d’un BAT devrait soutenir la compétitivité des entreprises américaines, supprimer l’incitatif existant à maintenir les bénéfices à l’étranger et augmenter les recettes nécessaires au financement d’une réduction importante du taux d’impôt sur le revenu des entreprises (actuellement le plus élevé de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)). De plus, cela équivaudrait à adopter une TVA, que la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis appliquent déjà, ce qui permettrait d’uniformiser les règles du jeu. Cependant, il est possible que certains partenaires commerciaux fassent appel à l’OMC et lancent des mesures de rétorsion—bien que nous estimions que le risque de guerre commerciale soit limité.
Nous prévoyons que le dollar américain s’apprécie, mais pas assez pour contrebalancer complètement l’impact du BAT sur la compétitivité des importations et des exportations. Par conséquent, la hausse des prix à l’importation impliquerait une montée temporaire de l’inflation, que nous estimons autour d’un point de pourcentage. Certaines sociétés américaines concurrencées par les importations pourraient acquérir des parts de marché grâce au remplacement des importations, bien que leur réussite dans ce domaine dépende également des gains sur placement et des gains de productivité. Les entreprises exportatrices en ressortiraient gagnantes, tandis que les entreprises importatrices, y compris les gros détaillants et les raffineries, en ressortiraient pénalisées. Toutefois, en partant du principe que les tensions commerciales seraient maîtrisées, nous pensons que l’ajustement des politiques améliorerait l’environnement commercial général, stimulerait l’investissement et accélèrerait l’activité économique.
Pour plus détails sur ce sujet, vous pouvez lire « Global Macro Shifts », une note de recherche consacrée aux économies mondiales et qui reprend l’analyse et les opinions du Dr. Hasenstab et des experts de Templeton Global Macro. Le Dr. Hasenstab et son équipe gèrent les stratégies obligataires mondiales de Templeton, notamment les fonds obligataires non contraints, ainsi que les fonds exposés au marché des changes et à la conjoncture macroéconomique internationale. Cette équipe d’économistes, qui ont été formés dans les plus grandes universités du monde, intègre des analyses macroéconomiques mondiales à sa recherche approfondie sur les pays afin de pouvoir identifier des déséquilibres à long terme représentant des opportunités d’investissement.
-
Source : Perspectives de l’économie mondiale du FMI, octobre 2016.
Quels sont les risques ?
Tout investissement comporte un risque, notamment celui de ne pas récupérer le capital investi. La valeur des investissements peut fluctuer à la baisse comme à la hausse, et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer la totalité de leur mise initiale. Les investissements à l’étranger comportent des risques spécifiques, comme les variations des taux de change, l’instabilité économique et l’évolution de la situation politique. Investir dans les marchés émergents, y compris dans la sous-catégorie des marchés frontières, implique des risques accrus concernant ces mêmes facteurs, lesquels s’ajoutent aux risques liés à leur plus petite taille, à leur liquidité inférieure et à l’absence d’un cadre juridique, politique, commercial et social établi pour soutenir les marchés boursiers. Les risques liés à l’investissement dans les marchés frontières sont encore supérieurs à ceux associés aux marchés émergents en raison du développement moins avancé des structures précitées, ainsi que du potentiel de forte volatilité des prix, de la liquidité insuffisante, des barrières commerciales et des contrôles sur les taux de change. Les prix des obligations évoluent généralement dans le sens opposé des taux d’intérêt. Ainsi, lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur d’un portefeuille obligataire peut reculer.